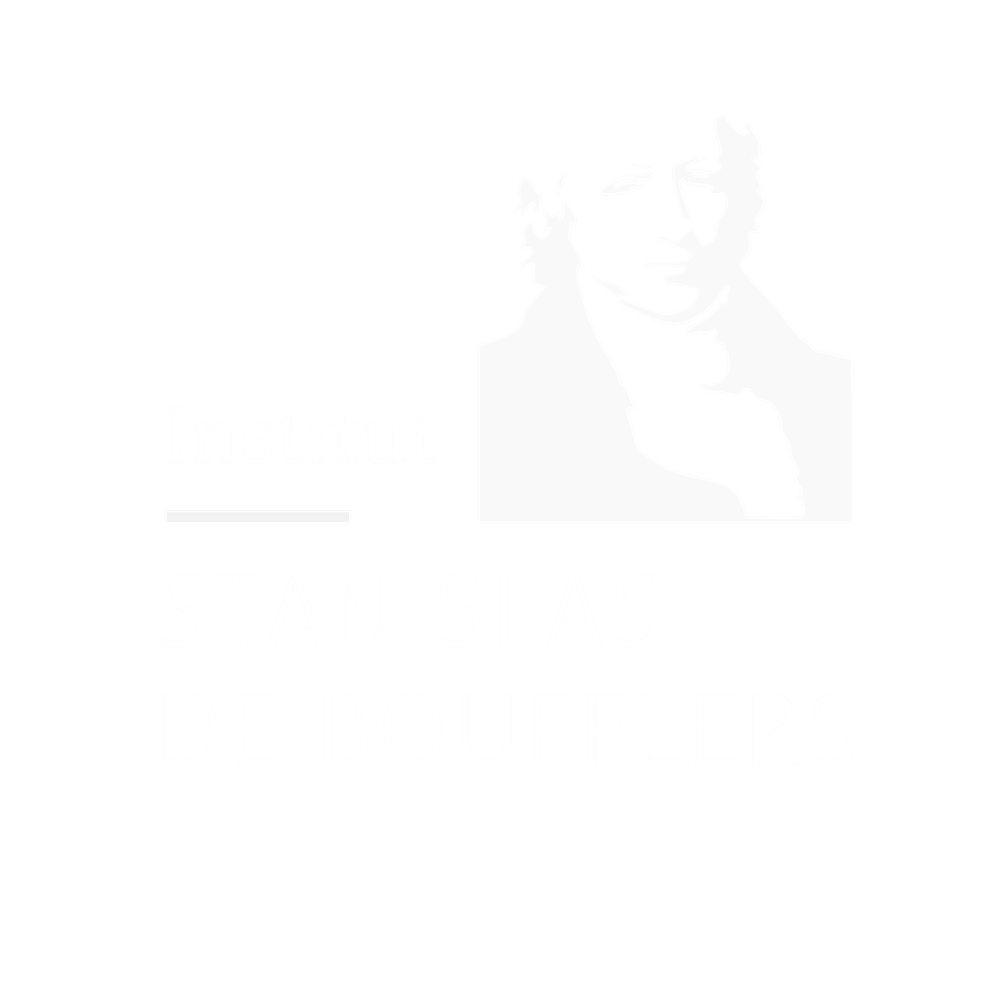L’exercice est évidemment périlleux car environ 230 années nous séparent de la Révolution française. Cependant, il est fort probable que s’ils posaient leurs regards sur le droit d’auteur d’aujourd’hui, De Boufflers, Le Chapelier, Lakanal et les philosophes des Lumières ayant au 18e siècle théorisé la matière seraient attristés du sort qu’a connu le droit d’auteur qu’ils ont aidé à émerger puis consacrer.
Tout d’abord, parce que le bilan pour les auteurs de ce dispositif législatif est plus que mitigé. Si à la fin du 18e siècle, le droit de propriété octroyé à l’auteur sur son œuvre était censé lui donné une indépendance financière et intellectuelle par rapport au mécène dont il dépendait souvent sous l’Ancien Régime, force est de constater qu’aujourd’hui uniquement une petite minorité d’auteurs réussissent à vivre grâce aux revenus générés par leurs œuvres et qu’une grande majorité d’auteurs sont dépendants de revenus générés par d’autres activités, notamment de type « alimentaires ». Le Professeur Dietz, grand théoricien du droit contractuel allemand, tirait déjà la sonnette d’alarme dans les années 1980 en soulignant que trop nombreux étaient les auteurs qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté et que l’aide sociale avait été probablement plus bénéfique aux auteurs qu’un quelconque droit d’auteur à leur profit.
Nos législateurs révolutionnaires seraient ainsi peinés de constater que leur rhétorique visant à ancrer le droit d’auteur dans le droit naturel afin de lui donner une légitimité par rapport à l’arbitraire de l’octroi des privilèges royaux a été utilisée comme argument phare par la pensée traditionnaliste du droit d’auteur, qui y a vu la consécration d’un droit d’auteur dit « à la française » (à tort, selon nous, car le droit français permet d’autres lectures), sacralisant le droit d’auteur sans se préoccuper suffisamment du sort concret des auteurs. Il y a bien eu quelques tentatives de corriger le tir, notamment en mettant en place des règles protectrices des auteurs vis-à-vis des exploitants, comme le principe de l’octroi d’une rémunération proportionnelle au profit de l’auteur. Mais la « proportion » hélas est souvent restée minime, une rémunération proportionnelle ne signifiant pas que celle-ci soit appropriée, ce qu’est d’ailleurs venu rappeler récemment le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 novembre 2022, sanctionnant le législateur français qui malgré la directive de 2019 (laquelle avait essayée de redresser la barre au profit des auteurs, s’inspirant pour ce faire fortement du droit allemand) avait estimé que les dispositions du droit français était suffisante pour assurer une juste rémunération des auteurs. Aussi louables que soient ces règles protectrices, ces dispositifs se révèlent malheureusement souvent peu efficace en pratique car les auteurs n’aiment pas se retourner contre leurs financeurs. « Mieux vaut ne pas mordre pas la main qui vous nourrit », comme le dit le dicton. Voilà donc un paradoxe du droit d’auteur dans sa conception traditionaliste : le droit d’auteur est sacralisé, mais les poches des auteurs restent souvent vides !
A vrai dire, dans le système en place, le véritable bénéficiaire du droit d’auteur est la plupart du temps l’exploitant, le producteur, l’investisseur, lequel se fera systématiquement céder par l’auteur des droits d’exploitation sur l’œuvre pour toute leur durée (c’est la conséquence logique de la propriété, elle peut être cédée pleinement). Les exploitants ont très tôt perçu la force intuitive de la mise en avant d’un droit naturel de propriété au profit de l’auteur : on se rappellera que lorsque le Diderot rédigea au 18ème siècle ses vibrants plaidoyers en faveur de la propriété intellectuelle, c’est en tant qu’avocat des libraires de province dans leurs litiges contre les libraires de Paris, lesquels se faisaient attribuer la majorité des privilèges royaux. Doté de l’arme propriétaire, l’exploitant est ainsi fortement gagnant : il bénéficiera en tant qu’investisseur d’un droit très fort dont les règles et la durée sont dessinés par rapport à l’auteur personne physique, créateur de l’œuvre : qu’on ne songe qu’à la durée du droit très longue (notamment par rapport au droit des brevets) allant jusqu’à 70 après la mort de l’auteur. Comme on a pu l’écrire, le rôle de l’auteur ainsi dépossédé n’est alors souvent plus que de mourir pour pouvoir donner une date certaine à l’expiration du monopole. Et comme les auteurs ont continué à vivre de manière précaire malgré l’avènement d’une batterie de droits à leur profit, les exploitants n’auront de cesse de demander, en leur nom, un renforcement du droit d’auteur et de sa mise en œuvre. Il est tellement plus efficace face aux décideurs que de mettre en avant les pauvres auteurs pour demander un renforcement de prérogatives qui sont, de facto, exercées par les exploitants. L’argument intuitif de Diderot est toujours resté très efficace en particulier, lorsqu’il est combiné avec la nécessaire garantie de la diversité culturelle. L’opinion publique et les décideurs ne faisant pas toujours la différence, l’argumentaire sera également utilisé par les exploitants pour demander des droits directement à leur profit, avec pour conséquence la consécration à tout va de droits divers pour les investisseurs : droits voisins, sui generis, connexes, voir droits immatériels qui taisent souvent leur nom, venant multiplier les interdits et les péages en leur faveur. Et on en demande toujours plus : une fois ces droits consacrés, ils font alors l’objet de prolongation dans la durée, à l’instar du droit voisin du producteur de phonogramme dont la durée a été augmentée par le législateur européen en 2011.
Récemment, c’est l’argument de maitre du « Value gap » qui s’est révélé payant : il faut partager la valeur générée par l’exploitation des œuvres en ligne. On ne peut que souscrire intuitivement à cette revendication, mais quand on y regarde de plus près : partager la valeur certes, mais au profit de qui ? Il restera à démontrer si les obligations nouvelles imposées aux plateformes par le législateur européen à la suite d’une grande pression des industries culturelles amélioreront vraiment la situation des auteurs créateurs de contenus. Cela dépendra très probablement, comme depuis toujours, de leur notoriété et de leur capacité à négocier avec leurs exploitants de justes rémunérations lors de la cession de leurs droits (et généralement aussi incidemment de leur capacité à se faire conseiller juridiquement car le langage du droit d’auteur et sa complexité ne rend pas les règles du jeu facilement compréhensibles).
Face à cela, une doctrine alternative a mis en avant la nécessité de réfléchir au développement des droits à rémunération au profit des auteurs, en addition ou à la place des droits d’interdire qui souvent leur échappent, lesquels ne pourraient pas être cédés, à l’image des rémunérations pour copie privée qui par ailleurs génèrent d’importants revenus pour les auteurs. Ces propositions attirent en général immédiatement les foudres des gardiens du temple : on s’offusque d’une dénaturation du droit d’auteur, on brandit le spectre de la socialisation, le déclassement des prérogatives de l’auteur, comme si le droit à rémunération serait un « moins bien » par rapport au droit d’interdire ; si cela devait être un manque à gagner, cela le serait pour l’exploitant qui doit partager plus largement ses gains, non pour l’auteur. Ce dernier au contraire bénéficie en général d’un pourcentage de redistribution bien plus favorable que celui qu’il aurait obtenu en négociant la cession de son droit. Certains tribunaux européens sont d’ailleurs venus explicitement le souligner lorsque certains exploitants ont essayé de remettre en cause l’extension des droits à rémunération au profit des auteurs en brandissant le fameux « test des trois étapes », lequel est censé contenir toute restriction des droits exclusifs. Pourtant, les esprits évoluent peu à peu. On se souviendra par exemple que les licences d’office en matière de brevet étaient encore très mal vues dans un passé encore récent et qu’elles se sont pourtant imposées comme un compromis utile et acceptable pour lutter contre la pandémie du COVID-19.
Pourtant la propriété intellectuelle dans l’esprit du 18e siècle était bien une propriété « d’un genre tout à fait différent des autres propriétés », pour reprendre l’expression de Le Chapelier. C’était une propriété finalisée, censée bénéficier à la société, et qui ne sauraient donc être exercée de manière discrétionnaire ou égoïste. Elle était censée permettre aux auteurs de vivre de leur plume tout en assurant une diffusion des œuvres au sein du corps social et un développement intellectuel et culturel. Comme le rappelle pertinemment Pascal Attali (voir sur ce blog « Le brevet, une invention de génie », 19 octobre 2022), le chevalier De Boufflers le savait bien lorsqu’il plaida pour l’octroi d’une propriété limitée sur les inventions et qu’il réussit à convaincre le législateur révolutionnaire de la pertinence du modèle : le Zeitgeist de la révolution lui imposa d’insister sur le contrat social et le bénéfice collectif résultant de la consécration d’un droit de brevet au profit de l’inventeur.
On peut d’ailleurs supposer que cette perte de vue des intérêts collectifs dans l’évolution postérieure du droit d’auteur chagrinerait également nos penseurs du 18e siècle et le fait que se multiplient aujourd’hui les points de friction entre le droit d’auteur et la liberté d’expression, le droit à l’information et la liberté de création les scandaliseraient au plus haut point. Il ne faut en effet pas oublier que les philosophes des Lumières qui s’étaient faits les ardents défenseurs des droits des auteurs sur leurs œuvres concevaient la plupart du temps le droit d’auteur comme une garantie de la liberté d’expression et que pour eux, accorder un droit aux auteurs, c’était permettre la diffusion des idées et du savoir, l’auteur ayant une mission éducative, chargé d’« éclairer » les citoyens. Condorcet, dans ses Fragments sur la liberté de la Presse de 1776 le traduit très bien, estimant que « le bonheur des hommes dépend en partie de leurs lumières, et le progrès des lumières dépend en partie de la législation de l’imprimerie. Cette législation n’eût-elle aucune influence sur la découverte des vérités utiles, elle en a une prodigieuse sur la manière dont les vérités se répandent. Elle est une des véritables causes de la différence qui existe entre les opinions des hommes éclairés, celle du public et les opinions des gens qui remplissent des places ». On ne citera pas ici les longs développements du rapporteur de la loi de 1791 Le Chapelier, car d’autres l’ont fait brillement avant nous, soulignant l’importance des intérêts de la collectivité voir des droits du public dans son fameux discours sur « la plus sacrée, la plus légitime et la plus inattaquable des propriétés ». A notre avis, il aurait d’ailleurs peu apprécié l’exploitation abusive que certains ont fait de cette formule, laquelle a été systématiquement citée hors de son contexte pour faire de lui le porte-parole d’une vision sacralisée du droit d’auteur, alors que l’on sait depuis les très sérieux travaux de Jane Ginsburg, Alain Strowel, Gillian Davies et bien d’autres que son discours était teinté de très nombreuses considérations utilitaristes.
On rappellera également que lien étroit entre droit d’auteur et diffusion du savoir se retrouve dans le fait que le deuxième décret du 19 juillet 1793 est élaboré par le Comité d’Instruction publique. Difficile donc d’imaginer qu’aujourd’hui encore, les exceptions au droit d’auteur à des fins d’éducation et de recherche restent cantonnées dans des limites très étroites, que les exceptions visant à permettre la fouille de texte et de données ne sont pas à la hauteur de ce que nécessitent une vrai société de l’information, que les auteurs se voient interdire la mise en ligne d’une version de travail de leurs travaux par les exploitants auxquels ils ont cédés les droits, que des barbelés techniques (appelés en jargon du droit d’auteur « les mesures techniques de protection des œuvres ») sont venus restreindre l’accès aux œuvres alors que les réseaux rendent possibles la mise en place d’archives virtuelles permettant à tous d’accéder à la connaissance. Ou que des héritiers s’acharnent à interdire l’utilisation à des fins créatives des œuvres, venant ainsi mettre un énorme frein à la liberté d’expression de nombreux artistes et internautes, et par là même au développement culturel. On ne peut ainsi que saluer le Tribunal de judiciaire de Rennes du 10 mai 2021 qui, sur le fondement de la parodie et de la liberté d’expression, a permis à un artiste l’utilisation décalée dans ses toiles du personnage de Tintin, icône culturelle à laquelle on doit pouvoir faire référence dans un contexte artistique. Paraphrasant quasiment mot pour mot la Cour constitutionnelle allemande qui avait validé certaines utilisations créatives des œuvres au visa de la liberté de création, le tribunal considère « que la violation alléguée des droits de l’auteur est de faible ampleur et n’entraîne qu’une perte financière minime voire totalement hypothétique pour les ayants droit, lesquels ne peuvent s’opposer à la liberté de création, l’intérêt de l’artiste à la libre utilisation de l’œuvre dans le cadre d’une confrontation sur le terrain artistique devant prévaloir sur les simples intérêts financiers des titulaires de droit ». Un tel raisonnement aurait certainement plu à nos penseurs des Lumières, eux qui faisaient à n’en pas douter de l’irrévérence à l’ordre culturel et politique établi le fondement de leur engagement. En tout état de cause, ils n’auraient certainement pas accepté que le droit d’auteur soit utilisé comme un moyen de censure.
Alors, que peut-on conclure de ces quelques réflexions ? Il nous semble que le discours sur le droit d’auteur doit évoluer : on ne peut plus s’interdire de réfléchir à de nouveaux mécanismes de protection et de remettre en cause certains principes qui n’ont pas -du moins pas toujours- fournis les résultats escomptés. Le système nécessite à minima un audit indépendant et objectif, ne serait-ce que pour se (re)convaincre de la pertinence du modèle. Il convient également de s’interroger sur la gouvernance du système en place : en effet, il n’est pas certain que face à la rapidité des développements techniques et sociétaux, le législateur et les tribunaux soient toujours les mieux placés pour proposer les évolutions nécessaires au cadre juridique en place et il faudra demain imaginer des autres structures de création de la norme pouvant accueillir une réflexion plus large (nous avons ainsi plaidé depuis plusieurs années pour la mise en place d’une institution indépendante au sein de l’Union européenne pour anticiper et accompagner les réformes du droit d’auteur ainsi que leur mises en œuvre). Les « think tank » sont dans ce contexte des lieux précieux d’expertises : ils doivent pouvoir être pleinement entendus et ne pas servir uniquement de faire valoir lorsque les recommandations vont dans le sens voulus (et être poliment ignorés lorsque cela n’est pas le cas). Pour en revenir au droit d’auteur, une refonte autour des principes solidement ancrés dans le droit international des droits de l’homme nous paraitrait, en raison de leur universalité, une bonne piste à suivre : garantie d’un droit d’accès à la science et à la culture ainsi que protection des intérêts matériels et moraux des créateurs. Faisons le pari que de De Boufflers, Le Chapelier, Lakanal et les penseurs éclairés du droit d’auteur du 18e siècle, dont les idées avaient à n’en pas douter une vocation universaliste, n’y auraient rien à redire !
Christophe Geiger
Professeur à l’université Luiss Guido Carli (Rome)